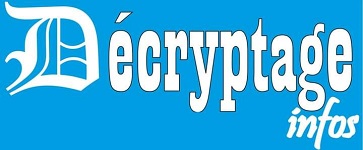L’ÉCONOMIE BLEUE ET LA PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES MARINS : UN ENJEU POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU BÉNIN
🔹L’économie bleue repose sur l’utilisation durable des ressources marines et côtières pour promouvoir la croissance économique, l’inclusion sociale et la conservation de l’environnement. Selon la Banque Mondiale (2020), l’économie bleue pourrait représenter environ 3 % du produit intérieur brut (PIB) mondial d’ici 2030, avec un potentiel de croissance considérable dans les régions côtières. Au Bénin, les écosystèmes marins jouent un rôle vital dans le développement économique, notamment à travers les activités portuaires, la pêche et le tourisme côtier. Le Port Autonome de Cotonou, par exemple, représente 90 % du trafic maritime du pays, traitant plus de 3 millions de tonnes de marchandises chaque année (Port Autonome de Cotonou, 2022). En outre, le secteur de la pêche génère environ 1 % du PIB national et emploie près de 100 000 personnes dans les zones côtières (FAO, 2021).
🔹Cependant, ces activités entraînent des dégradations environnementales qui menacent la biodiversité marine et la résilience des zones côtières. Une étude menée par ONU Environnement (2021) révèle que 80 % de la pollution marine dans les pays en développement provient des déchets plastiques et des déversements d’hydrocarbures, un phénomène également observé au Bénin. Cette situation a des impacts directs sur les écosystèmes marins et les communautés côtières, notamment à travers la perte de biodiversité et l’érosion des littoraux.
🔹Le secteur d’étude est compris entre 6°22’30 » et 6°30’0 » de latitude Nord et 2°2’30 » et 2°28’0 » de longitude Est. Il est composé de trois Communes, à savoir : la Commune de Ouidah, la Commune d’Abomey-Calavi et la Commune de Cotonou . (Port autonome de Cotonou )

🔹Cette analyse examine les impacts des activités portuaires et industrielles sur la biodiversité marine, la gestion de la pollution plastique, l’adaptation au changement climatique et les stratégies pour une exploitation durable des ressources halieutiques. L’objectif est d’identifier les leviers permettant de concilier développement économique et préservation des écosystèmes marins. Les recommandations proposées visent à favoriser une transition vers une économie bleue durable, où la croissance économique est compatible avec la protection de l’environnement.
L’impact des activités portuaires et industrielles sur la biodiversité marine
🔹L’expansion des infrastructures portuaires, notamment au Port Autonome de Cotonou, modifie les écosystèmes côtiers. Le dragage des fonds marins perturbe les habitats marins et augmente la turbidité de l’eau, affectant la photosynthèse des organismes aquatiques. Les déversements d’hydrocarbures et de métaux lourds polluent l’eau et impactent la faune et la flore marines.
Par ailleurs, la construction d’infrastructures portuaires réduit les zones de mangroves, essentielles pour la reproduction des poissons et la protection des littoraux contre l’érosion. Une gestion plus durable des activités industrielles est donc cruciale pour limiter ces effets négatifs.
🔹Lutte contre la pollution marine et gestion des déchets plastiques
La pollution marine, en particulier celle causée par les déchets plastiques, constitue aujourd’hui une menace croissante pour les écosystèmes marins du Bénin. En effet, les rejets provenant des activités portuaires et urbaines se retrouvent fréquemment dans les eaux côtières, entraînant la dégradation des habitats marins et l’intoxication des espèces aquatiques. Selon une étude de l’ONU Environnement (2021), plus de 80 % des déchets marins sont constitués de plastiques, ce qui aggrave la perte de biodiversité et perturbe l’équilibre écologique des océans.
Évolution de la pollution plastique marine au Bénin (2010-2024)
🔹Face à cette problématique, plusieurs initiatives locales et internationales ont vu le jour. Les campagnes de nettoyage des plages, la mise en place de systèmes de collecte et de recyclage, ainsi que la réglementation des plastiques à usage unique constituent des solutions envisageables. Toutefois, pour maximiser leur efficacité, ces mesures doivent être accompagnées d’une sensibilisation accrue des populations et d’un renforcement des politiques publiques visant à réduire la production et l’utilisation des plastiques non recyclables.

Indicateurs
Valeurs 2024
Évolution depuis 2010
Pourcentage de déchets plastiques dans les eaux côtières
80 %
+30 %
Volume annuel de déchets plastiques rejetés en mer (tonnes)
15 000 t
+50 %
Nombre d’espèces marines affectées par la pollution plastique
200+
+40 %
Tableau 1 : enquête de terrain mars 2024 la Pollution Marine et Gestion des Déchets Plastiques
2. Initiatives mises en place
Initiatives
Objectifs
Résultats 2024
Campagnes de nettoyage des plages
Réduction des déchets sur le littoral
50 tonnes de déchets collectés
Systèmes de collecte et de recyclage
Augmenter le taux de recyclage des plastiques
30 % des déchets recyclés
Réglementation sur les plastiques à usage unique
Réduction de la production et consommation de plastiques
Loi adoptée en 2023, application partielle
🔹Adaptation au changement climatique et résilience des zones côtières
En parallèle de la pollution marine, le changement climatique représente un autre défi majeur pour les zones côtières béninoises. La montée du niveau de la mer, l’érosion accélérée des plages et l’augmentation de la fréquence des tempêtes fragilisent les infrastructures portuaires et menacent les communautés littorales. D’après le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, 2019), le niveau moyen de la mer pourrait s’élever de 0,5 à 1 mètre d’ici la fin du siècle, mettant en péril les populations vivant dans les zones basses du littoral béninois.
Pour faire face à ces menaces, il est essentiel de renforcer la résilience des côtes à travers des approches fondées sur la nature. La restauration des mangroves et la protection des dunes de sable jouent un rôle clé dans la stabilisation des rivages et la limitation de l’érosion. En complément, la mise en place de politiques publiques adaptées, incluant des plans d’urbanisation intégrant les risques climatiques, est nécessaire pour protéger durablement les littoraux et les populations vulnérables.
🔹Mise en place de stratégies pour une exploitation durable des ressources halieutiques
Enfin, un autre enjeu crucial pour l’économie bleue au Bénin est la gestion des ressources halieutiques. La surexploitation des stocks de poissons, exacerbée par la pêche illégale et non réglementée, menace à la fois la biodiversité marine et la sécurité alimentaire des populations côtières. Selon la FAO (2021), environ 34 % des stocks mondiaux de poissons sont exploités à un niveau non durable, une tendance également observée dans les eaux béninoises.
Pour garantir une exploitation responsable et durable des ressources marines, plusieurs mesures doivent être mises en place. Il s’agit notamment d’un meilleur encadrement de la pêche artisanale et industrielle, du développement de l’aquaculture durable et de l’instauration de zones de protection marines. Ces actions, combinées à un contrôle renforcé des pratiques de pêche, permettront non seulement de préserver les écosystèmes marins, mais aussi d’assurer une pérennité économique aux communautés qui dépendent de cette activité.
L’économie bleue représente un levier essentiel pour le développement du Bénin, mais son expansion doit impérativement s’accompagner de mesures de protection des écosystèmes marins. Une approche équilibrée entre croissance économique et préservation environnementale est indispensable pour garantir une exploitation durable des ressources maritimes.
À cet effet, nous recommandons :
🔹Renforcer la réglementation environnementale pour limiter l’impact des activités portuaires et industrielles sur les milieux marins.
🔹Mettre en place des programmes de gestion des déchets plastiques, en encourageant le recyclage et en réduisant l’utilisation des plastiques à usage unique.
🔹Développer des stratégies d’adaptation au changement climatique, notamment en investissant dans des solutions basées sur la nature pour protéger les zones côtières.
🔹Favoriser une gestion durable des ressources halieutiques, en réglementant la pêche et en promouvant l’aquaculture responsable.
🔹Enfin, la mise en œuvre d’une gouvernance maritime intégrée, impliquant le gouvernement, le secteur privé, les organisations internationales et les communautés locales, sera essentielle pour assurer la durabilité de l’économie bleue au Bénin. Seule une action concertée et durable permettra de préserver les richesses marines tout en garantissant leur exploitation pour les générations futures.
Une Analyse faite par Dr Damien Ahouandokoun, expert en économie maritime et portuaire , Specialiste en Aménagement Portuaire et écologie
Références bibliographiques
FAO (2023). L’économie bleue et la gestion durable des ressources marines en Afrique de l’Ouest.
Banque Mondiale (2022). Impact des infrastructures portuaires sur la biodiversité côtière.
ONU Environnement (2021). Stratégies pour la réduction de la pollution plastique dans les océans.
Institut National de la Statistique du Bénin (2020). Données sur la pêche et l’exploitation des ressources marines.
IPCC (2019).
Rapport spécial sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatiqu