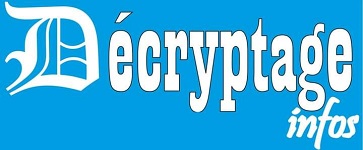Océan Atlantique et sécurité halieutique : À la veille du Sommet de Nice, la pêche ouest-africaine face au mur
En juin prochain, la conférence des Nations unies sur l’océan se tiendra à Nice. Pour les États côtiers africains, cette rencontre intervient dans un contexte d’alerte généralisée sur l’avenir des ressources halieutiques, où l’épuisement des stocks, les effets du climat et la concurrence des flottes industrielles remettent en cause tout un modèle de subsistance et de croissance.
La troisième Conférence des Nations unies sur l’océan, coorganisée par la France et le Costa Rica, s’ouvrira à Nice dans un climat tendu pour les pays riverains de l’Atlantique africain. Ce sommet s’inscrit dans le cadre de la « Décennie des Nations unies pour l’océan », mais pour de nombreux acteurs du littoral ouest-africain, il marque un point de non-retour. Car les signaux sont désormais convergents : raréfaction des sardines et sardinelles, chute drastique des captures artisanales, tensions entre pêcheurs locaux et industriels, et régression inquiétante des stocks de petits pélagiques sur la façade atlantique. Le Sénégal, en première ligne, incarne cette crise. En deux décennies, ses captures artisanales de sardines ont fondu de 60 000 à moins de 7500 tonnes. À la pression de la surpêche s’ajoutent les effets du dérèglement climatique, qui pousse les bancs de poissons au nord, loin des zones de pêche traditionnelles. Dans cette zone où plus d’un tiers des stocks halieutiques sont déjà surexploités, l’absence de coordination régionale, de transparence sur les quotas et d’harmonisation des politiques de gestion aggrave la situation. La compétition acharnée entre flottes locales et navires industriels sous pavillon étranger : européen, chinois ou russe, fragilise un peu plus chaque année la résilience des écosystèmes. Dans cet environnement fragmenté, un pays concentre aujourd’hui les regards : le Maroc. Avec ses investissements massifs dans la filière halieutique et sa domination logistique sur le littoral saharien, le Royaume dispose d’un levier régional. À Dakhla, plus de 14 000 emplois dépendent directement du secteur. Pourtant, les tensions montent. Les captures pélagiques ont chuté de 25 % au premier trimestre 2025. Et l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, qui remet en cause les accords de pêche dans les eaux du Sahara, menace les exportations marocaines vers l’Europe. Le débat prend donc une dimension stratégique. Faut-il imposer un moratoire saisonnier, comme l’a fait la Mauritanie, pour laisser le temps aux espèces de se reconstituer ? Le Maroc, seul acteur disposant de la puissance technique et institutionnelle nécessaire, pourrait jouer un rôle moteur. Sa décision, si elle venait à être prise à Nice, aurait une portée régionale immédiate. Ce sommet ne pourra se contenter de promesses vagues. Les États africains, confrontés à une réalité halieutique en pleine rupture, réclament des mesures concrètes : financements structurants, mécanismes de contrôle partagés, et reconnaissance des droits des communautés artisanales. Nice, en ce sens, n’est pas seulement une conférence. C’est une alerte. Et peut-être, la dernière occasion d’éviter que l’Atlantique ne devienne un désert marin.
Angelo Dowinhan